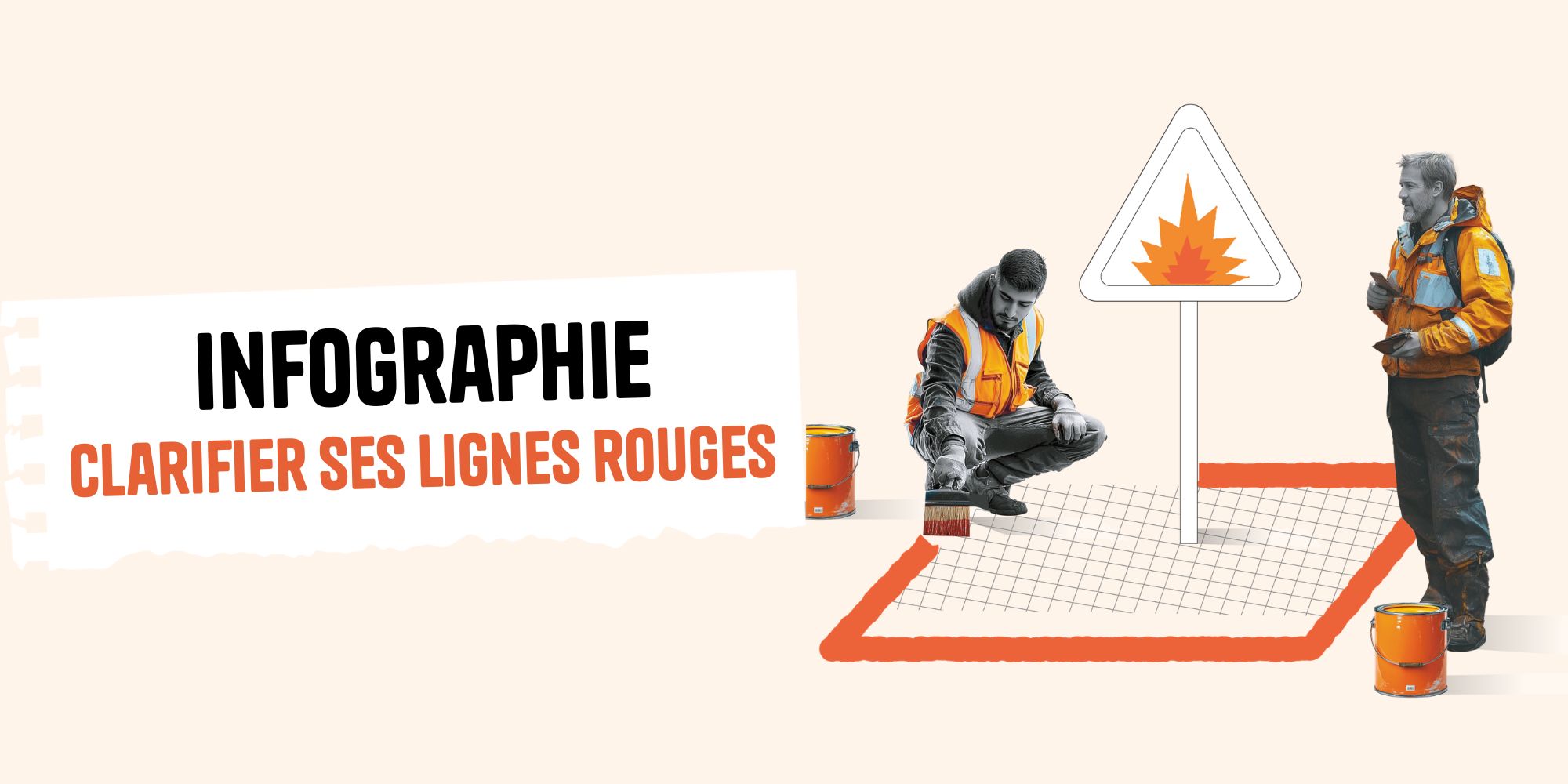Différencier les types de comportements et admettre le droit à l’erreur
 Les types de comportements et le droit à l'erreur
Les types de comportements et le droit à l'erreur
Une organisation où l’information circule reçoit parfois des bonnes nouvelles (bonnes pratiques, initiatives, succès, etc.) et parfois des mauvaises (situations à haut potentiel de gravité, écarts aux règles, dysfonctionnements, etc.). Comment lire, caractériser et traiter toutes ces situations avec objectivité ? Un premier prérequis est de partager un même vocabulaire : qu’est-ce qu’une contribution positive ? une erreur ? une transgression ? Et bien sûr, il sera nécessaire d’aborder collectivement la délicate notion de droit à l’erreur, fondamental dans une culture juste et équitable.
Distinguer comportements positifs, erreurs et transgressions
Qu’est-ce qu’un comportement ?
Les comportements, ce sont les « manières de faire ». C’est la partie de l’activité humaine qui est observable (gestes, postures, mouvements, mimiques, expressions verbales, utilisation d’outils et d’équipements, etc.). Ils sont influencés par de nombreux facteurs : les manières de penser (perceptions, croyances, valeurs, etc.), mais aussi par les situations de travail, le fonctionnement des collectifs, l’organisation du travail. En d’autres termes, observer les comportements, c’est observer la partie émergée de l’iceberg.
Les forces vives d’une organisation, ce sont les êtres humains qui y travaillent. Leur contribution à la sécurité est le plus souvent positive (gestion des situations à risque, détection et récupération des erreurs, initiatives pertinentes, etc.) mais, parfois, les individus sont faillibles.
Ainsi, il existe 3 familles des comportements vis-à-vis de la sécurité :
Les contributions positives
On y retrouve :
- la conformité et l’exemplarité (par rapport aux attendus),
- les contributions positives et proactives (au-delà de ce qui est attendu),
- l’engagement constant et remarquable vis-à-vis de la sécurité (qui s’inscrit dans la durée).
La plupart du temps, le travail se déroule en sécurité et les contributions positives sont de loin les plus répandues.
Les erreurs
Une erreur est une situation dans laquelle une action ne parvient pas à son but. Elle n’est pas volontaire mais peut avoir des effets non désirés. Il existe différents types d’erreurs :
- l’erreur de routine,
- l’erreur basée sur les règles,
- l’erreur de diagnostic,
- l’erreur induite par un dysfonctionnement latent.
Les transgressions
Une transgression est un écart volontaire par rapport au prescrit (règles, procédures, etc.). Une transgression ne comporte pas nécessairement l’intention de nuire, c’est même extrêmement rare ! On retrouvera :
- les transgressions imposées par la situation ou
- les transgressions liées à la performance,
- la transgression banalisée,
- la transgression dans un intérêt personnel,
- et enfin, la malveillance ou le sabotage (dans ce dernier cas, cela relève du pénal).
Les transgressions sont aussi appelées « violations » dans la littérature scientifique et certaines organisations.
Pourquoi il faut admettre le droit à l’erreur dans les organisations
La notion de « droit à l’erreur », c’est complexe, voire extrêmement sensible dans certaines entreprises… en particulier quand on cherche à prévenir les accidents graves, mortels et technologiques majeurs. Et c’est naturel : des vies sont en jeu… et si une erreur menait à un accident grave ?
Les limites de la focalisation sur l’erreur humaine en cas d’accident
Selon les neurosciences, les êtres humains commettent entre 2 et 5 erreurs par heure. La plupart des erreurs sont sans conséquence : elles sont récupérées par les individus eux-mêmes. Mais parfois, certaines erreurs passent entre les mailles du filet... et certaines peuvent être impliquées dans l’enchaînement de faits qui ont conduit à un accident.
Le coupable est alors tout désigné : l'erreur humaine. Mais c'est loin d'être une explication suffisante. Pour maîtriser les risques d'accidents graves, mortels et technologiques majeurs, il est du ressort de l’organisation de mettre en place des barrières :
- de prévention (pour empêcher l’exposition au danger),
- de récupération (pour reprendre en main la situation à risque)
- et d’atténuation (pour limiter les conséquences de l’évènement accidentel).
Quand l’accident survient, c’est que ces différentes lignes de défense ont été mises en défaut. L’erreur humaine n’est donc pas une explication suffisante pour expliquer un accident. Cela a même un effet délétère : focaliser sur l’erreur humaine (une cause apparente) empêche de rechercher les causes profondes, qu’elles soient techniques, organisationnelles voire managériales.
Focaliser l’analyse sur le dernier maillon de la chaîne ne permet pas de tirer les leçons de l’événement et de mettre en place les mesures de prévention susceptibles d’éviter son renouvellement.
Extrait du "Cahier" Facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle : un état de l’art, François Daniellou, Marcel Simard et Ivan Boissières (2010).
Une culture juste et équitable repose sur le fait que l’erreur est admise.
Pourquoi ?
- Parce qu’une erreur est toujours involontaire ! Ce qui signifie que les sanctionner ne réduira pas les erreurs.
- Parce qu’une erreur peut être la conséquence de dysfonctionnements latents (parfois multiples) ou être induite par les conditions dans lesquelles les salariés ont été placés (situation de travail, pression productive, etc.)
- Parce que l’important est de réfléchir à ce que l’organisation a mis en place pour détecter et récupérer les erreurs, et atténuer leurs conséquences,
- Parce que les salariés doivent se sentir en confiance et être encouragés à remonter spontanément leurs erreurs, plutôt qu’à les taire. Une erreur déclarée et c’est la sécurité qui progresse !
Attention ! Nous parlons bien ici d’une erreur isolée. La même erreur maintes fois répétée peut relever de la négligence, surtout si c’est accompagné d’une attitude désinvolte, négative, peu concentrée. Dans ces cas-là : une remobilisation est nécessaire, voire un un rappel à l'ordre selon la situation.
Admettre le droit à l’erreur ne signifie pas que « tout est permis » !
Une culture du laisser-faire est extrêmement dangereuse pour la sécurité : les transgressions (volontaires) aux règles sont à analyser pour adopter des réactions justes et appropriées, et le respect des règles fondamentales de sécurité doit être préservé à tout prix.
Se former à la culture juste et équitable
Notre formation de 2 jours en présentiel pour :
> apprendre à réagir de façon juste et équitable
> reconnaître les différents types de comportements
> intégrer les principes de la reconnaissance dans son management
> connaître les bonnes pratiques